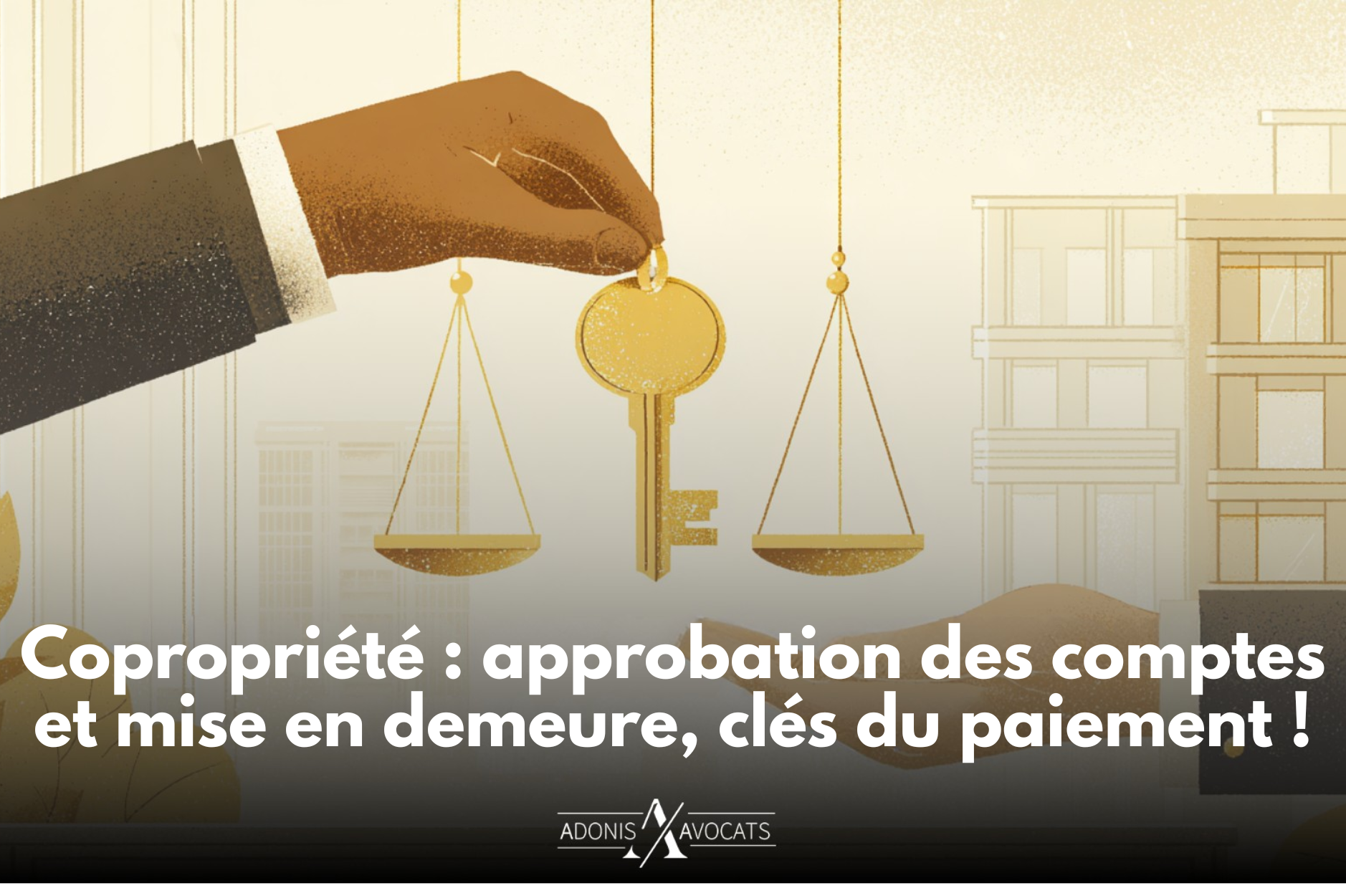Quand Paul a retrouvé son appartement saccagé après le départ de son locataire, il s’est senti impuissant. Murs troués, parquet rayé, équipements cassés : les dégâts dépassaient largement le dépôt de garantie. Désemparé, il s’est tourné vers les assurances et les recours juridiques, espérant une réponse rapide. Mais dans un contexte législatif où aucune réforme n’est prévue, peut-on dire que les bailleurs comme Paul sont réellement protégés ?
Le 24 juin 2025,le gouvernement a clairement répondu : pas de changement législatif à l’horizon. Selon lui, les outils existants suffisent à protéger les bailleurs face aux dégradations locatives. Décryptons ensemble ces dispositifs, leur portée réelle, et les limites de cette protection.
Le dépôt de garantie : une première ligne de défense
Prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie permet au bailleur de se prémunir contre les éventuelles dégradations. Il est généralement équivalent à un mois de loyer hors charges pour une location vide (et jusqu’à deux mois pour une location meublée).
En théorie, ce montant sert à couvrir les réparations locatives en fin de bail. Mais dans les faits, lorsque les dégradations sont importantes – changement de sols, réparations structurelles, remise en peinture totale – le dépôt de garantie se révèle souvent insuffisant.
Exemple concret : Pour un loyer de 800 €, le dépôt ne dépassera pas 800 € (ou 1 600 € en meublé). Or, le coût moyen de remise en état après des dégradations importantes peut grimper à plusieurs milliers d’euros. Autrement dit, le dépôt constitue une protection de base, mais pas un bouclier complet.
La responsabilité du locataire : un cadre juridique clair
L’article 7 de la même loi encadre les obligations du locataire. Il est responsable des dégradations et pertes constatées pendant la location dans les parties qu’il occupe, sauf exceptions :
· cas de force majeure (ex. : inondation),
· faute du bailleur (ex. : absence d’entretien de la toiture),
· action d’un tiers non introduit par le locataire (ex. : cambriolage).
Le locataire est également tenu d’assurer l’entretien courant du logement (robinetterie, menues réparations, nettoyage, etc.), ainsi que les réparations locatives définies par décret.
Ce cadre juridique est clair, mais encore faut-il que le locataire soit solvable ou de bonne foi. Dans le cas contraire, même avec des preuves solides, il peut être difficile pour le bailleur d'obtenir réparation sans passer par une procédure judiciaire longue et coûteuse.
L’état des lieux : un outil crucial… mais parfois sous-estimé
Le comparatif entre l’état des lieux d’entrée et de sortie est souvent décisif. Ces documents, réalisés de manière contradictoire (en présence du locataire et du bailleur ou de leurs représentants), permettent d’objectiver les éventuelles dégradations.
En cas de désaccord sur les responsabilités ou le montant des réparations :
· les parties peuvent saisir la commission départementale de conciliation (CDC), gratuite et accessible,
· ou le tribunal judiciaire, pour trancher le litige.
Ce processus peut prendre du temps et nécessite souvent un accompagnement juridique. De plus, l’état des lieux doit être précis, daté, signé et idéalement illustré par des photos. Trop souvent, les bailleurs négligent cet aspect, ce qui peut les pénaliser en cas de litige.
Une protection suffisante… selon le gouvernement
Dans sa réponse ministérielle n°3710 du 24 juin 2025, l’État estime que les dispositifs existants suffisent à garantir les droits des propriétaires. Autrement dit, aucun projet de loi n’est prévu pour renforcer leur protection.
Pourtant, les associations de bailleurs dénoncent une asymétrie dans les rapports locatifs. Face à un locataire défaillant ou malhonnête, le parcours pour obtenir réparation reste semé d'embûches : délais de procédure, frais d’avocat, incertitudes sur la solvabilité du locataire…
Si vous êtes bailleur, la législation actuelle vous offre un socle de protection, mais vous devez agir avec rigueur :
· Exigez un état des lieux précis et bien documenté.
· Souscrivez une assurance loyers impayés et dégradations (si votre profil le permet).
· Restez vigilant dans le choix du locataire (analyse du dossier,garanties, comportement).
· Conservez toutes les preuves écrites (courriers, photos, mails).
En résumé, oui, lespropriétaires sont protégés, mais à condition d’être proactifs etinformés. Le droit vous soutient… mais ne vous dispense pas de prudence !


.png)